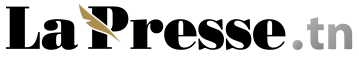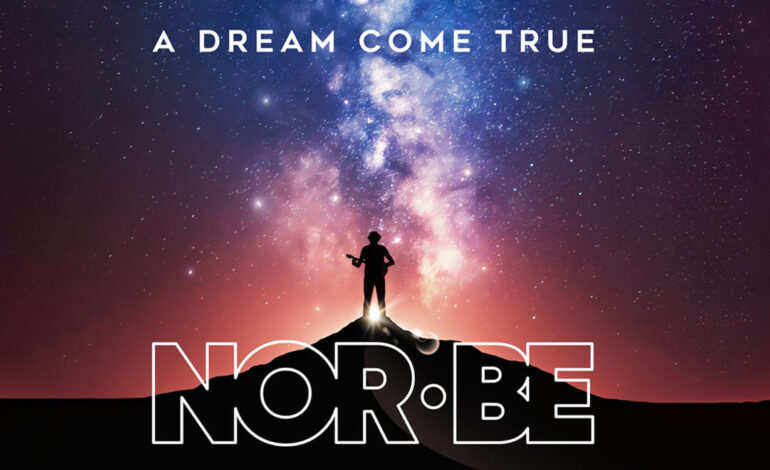Notes de lecture – M’hamed Hassine Fantar : Carthage et sa présence en Méditerranée
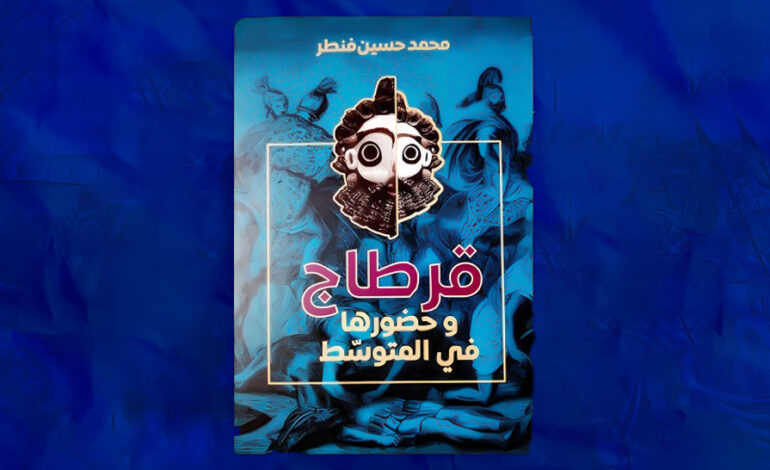
Edité par les soins de l’association « Générations Hilaliennes » au printemps dernier, ce volume de 628 pages traite de l’histoire de la prestigieuse métropole antique à la manière d’une visite guidée dans les couloirs d’un musée qui conduit de la naissance à l’extinction d’une des principales cités de l’Antiquité méditerranéenne en passant par son plein épanouissement.
Un traité d’histoire peut-il constituer une lecture d’été à la manière d’un roman ? Cela dépend du style adopté par son auteur. Dans le cas présent, nous avons entre les mains le dernier ouvrage en langue arabe du doyen des historiens tunisiens contemporains, M’hamed Hassine Fantar. A vrai dire, celui-ci s’est distingué parmi ses pairs par son art de la vulgarisation de la connaissance scientifique pour la mettre à la portée du public le plus large.
«Carthage et sa présence en Méditerranée » est la dernière en date des œuvres de ce savant prolifique. Edité par les soins de l’association «Générations Hilaliennes » au printemps dernier, ce volume de 628 pages traite de l’histoire de la prestigieuse métropole antique à la manière d’une visite guidée dans les couloirs d’un musée qui conduit de la naissance à l’extinction d’une des principales cités de l’Antiquité méditerranéenne en passant par son plein épanouissement.
Ce qui retiendra l’attention, de prime abord, c’est le style emprunté par l’auteur. Celui-ci, sans rien sacrifier de sa rigueur scientifique, recourt à une formulation à la portée de tout un chacun. Bien plus, il adopte un style narratif qui contraste avec la formulation lapidaire et absconse généralement en usage dans la sphère scientifique.
Il s’agirait presque d’un conte qui se déroule au fil de l’histoire avec un grand H. On embarque sur les côtes orientales de la Méditerranée pour partir à l’exploration des rivages opposés, là où se niche ce havre à la croisée de toutes les routes du bassin dans lequel une princesse va fonder le berceau d’une nouvelle civilisation.
L’auteur nous ouvre les portes de la cité légendaire et nous guide dans tous ses méandres : la société, le pouvoir, la politique et l’administration, l’économie, l’architecture et l’urbanisme et l’industrie. Tout cela en des chapitres dont la lecture peut s’effectuer en « tranches » indépendantes les unes des autres tout en étant réunies par le fil conducteur de l’histoire.
Puis s’ouvrent les horizons des conquêtes. Celles de nouveaux territoires mais aussi celles de la connaissance. Et avec elles les découvertes, les échanges… et les confrontations. Les guerres dites puniques sont un moment décisif de l’histoire de notre région. Et au-delà, qu’y a-t-il ? L’Au-delà, pardi ! Les croyances et les rites lesquels, bien plus tard, nous renseignent sur bien des aspects de cette civilisation qui, en dépit de sa longévité —huit siècles, sans compter leurs prolongements dans le quotidien de la population des siècles après— n’a pas su se faire adopter par les autochtones qui n’ont raté aucune occasion pour la combattre ?
C’est à cette question que répond la présentation de l’ouvrage en sa quatrième page de couverture. Et cette réponse est sous-jacente à tout le développement de l’ouvrage qui insiste sur l’échec de la civilisation punique à s’intégrer dans son environnement humain autochtone.